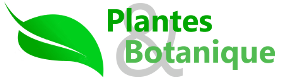Les Liliopsides représente la seconde sous-classe des Angiospermes. Elles sont souvent appelées monocotylédones.
Dans l'ensemble, on peut dire que les Liliopsides sont moins diversifiées, ne serait ce que par le moindre nombre de leurs espèces (55000 espèces en 70 familles), moins perfectionnées que les Magnolopsides. Les Liliopsides sont cependant une indiscutable réussite de l'évolution : nous y trouvons les familles peut-être les plus spécialisées et les plus cosmopolites du monde des Angiospermes (Orchidaceae, Poaceae...).
Origines et classification
C'est Bernard et Antoine-Laurent de Jussieu qui, au XVIII° siècle, ont rendu la distinction entre Liliopsides et
Magnolopsides essentielle. A l'heure actuelle, on pense que les Liliopsides se sont individualisées très tôt à partir de la souche commune des Angiospermes, souche aujourd'hui disparue mais proche des Magnoliidae. Ceci explique la présence de caractères à la fois archaïques et d'autres plus spécifiques.
Certains caractères sont archaïques, puisqu'elles sont issues d'une souche ancienne, marquée par de nombreux caractères ancestraux, parmi lesquels le cycle trimère moins perfectionné que les autres, la graine presque toujours à albumen persistant, le grain de pollen monoaperturé... D'autres sont très particuliers, ils sont dits monocotyloïdes, car ils ne se trouvent que chez les Liliopsides. En effet, ayant divergé très tôt, les Liliopsides ont eu tout le temps voulu pour évoluer dans un sens propre et tout à fait original. La cause de cette évolution serait à rechercher dans l'influence d'un habitat aquatique.
Quoi qu'il en soit, l'orientation évolutive des Liliopsides s'est traduite par une simplification des formes. Il y a eu « évolution simplificatrice ». Ainsi, on ne rencontre chez ce groupe qu'un seul cotylédon, des feuilles simplifiées, réduites au pétiole, aucunes formations secondaires.
En revanche, il semble que la voie suivie par les Liliopsides ne leur permettait plus, par la suite, une évolution aussi poussée que celle des Magnolopsides. Par exemple, il est certain que le fait de ne plus avoir de formations secondaires a réduit chez les Monocotyledones bien des possibilités d'adaptation : la forme arborescente est parfois bénéfique pour l'espèce.
Les Liliopsides, groupe moins diversifié que les Magnolopsides sont plus faciles à classer. On peut distinguer :
- des Liliopsides ancestrales : les Alismatidae et les Areciidae,
- des Liliopsides moyennes : majorité des Liliidae, Zingiberiidae
- des Liliopsides surevoluées, dont certains groupes évoluent encore à une vitesse rapide sous nos yeux : Commelidiinae, et Orchidales (Liliidae).

Appareil végétatif
L'embryonL'unique cotylédon qui caractérise cette classe d'Angiospermes résulte du non-developpement d'un des deux cotylédons. La croissance de l'unique cotylédon rejette sur le coté le point végétatif de la tige qui acquiert une position latérale caractéristique. Aussi, bien que la structure de l'embryon arrivé à son complet développement soit en apparence très différente chez les Liliopsides et Magnolopsides, l'origine du ou des cotylédons, ainsi que le fonctionnement du meristeme apical sont fondamentalement les mêmes chez les deux classes.
Les racines
Très généralement, la racine principale avorte dès la plantule. Elle est remplacée par de nombreuses racines adventives qui naissent à la base de la tige. Ce sont elles qui sont responsable du tallage des céréales. Ajoutons que la coiffe a perdu la faculté de différencier des poils absorbants, lesquels sont formés, grâce à un phénomène de compensation (loi de Dollo : "au cours de évolution d'une lignées, un organe disparu ne réapparaît jamais"), par le rhizoderme des extrémités des jeunes racines.
Il n'existe aucune Liliopside parasite : la raison en serait la perte de la racine principale, laquelle joue chez les Magnolopsides parasites le rôle d'organe de pénétration.

Structure de la racine type des Liliopsides.
Les tiges
Les tiges feuillées sont de type essentiellement herbacé, car l'évolution simplificatrice a fait disparaître les formations secondaires qui permettaient l'épaississement progressif des racines et des tiges chez les Magnolopsides et les
Gymnospermes, et qui sont la cause du port arborescent avec tronc et branches.
Chez ces groupes, les formations primaires sont très temporaires, très vite remplacées par les formations secondaires qui assurent la rigidité des organes. Aussi, les faisceaux conducteurs de sève n'ont besoin que d'être en petit nombre.
Il n'en est pas de même chez les Liliopsides, où les faisceaux ne sont pas remplacés par des structures secondaires : ils assurent la rigidité et il y a multiplication des faisceaux qui se répartissent sur plusieurs cercles.
Le caractère herbacé des Liliopsides se retrouve même chez les espèces tropicales (palmiers,
Yucca...) dont le port semble arborescent. Chez ces espèces, la tige n'est nullement constituée comme la tronc des arbres véritables. C'est une véritable tige herbacée rendue rigide et épaisse par le nombre très élevé des faisceaux et par l'importante sclérification du parenchyme. De plus, si la tige peut dans ces cas atteindre un volume assez important, c'est que le meristeme apical accroît progressivement sa circonférence jusqu'à ce qu'il ai atteint un diamètre définitif pour une espèce déterminée. Il en résulte que la tige a, sur une faible longueur, la forme d'un cône renversé dans sa partie la plus jeune, généralement enterrée et pourvue de nombreuses racines adventives, puis elle prend et conserve définitivement la forme d'un cylindre.
Pourtant, chez quelques rares espèces (Liliales arborescentes :
Yucca, Cordilyne, Dracaena...), le tronc accroît en diamètre, mais c'est par un mécanisme tout à fait différent de celui qui s'observe chez les vrais arbres : les cellules les plus externes du cylindre central se dédifférencient en un tissu dans lequel de nouveaux faisceaux conducteurs de sèves apparaissent.
Les tiges feuillées ne se ramifient généralement pas. Ce qui explique que les ports arbustifs ou buissonnant n'existent pas chez les Liliopsides. C'est, en fait, une conséquence de l'absence de cambium : une ramification arienne, pour être rigide, impose l'épaississement des axes les plus anciens.
Les feuilles
Les feuilles sont toujours simples et à nervation parallèle. Le limbe n'est jamais divisé en plusieurs folioles indépendantes. Les feuilles palmées ou pennées des palmiers semblent contredire ce fait ; en fait, leurs divisions ne sont que des déchirures du limbe. Les feuilles de Liliopsides n'ont, en fait, pas de véritable limbe, et sont réduites à la base foliaire et au pétiole : il en résulte un nervation parallèle. Par surevolution, limbe et stipules ont disparus. Par compensation, le pétiole s'aplatit en un faux limbe à nervures parallèles, tandis que la base foliaire devient très importante et constitue généralement une gaine enveloppant soit la tige, soit les feuilles les plus jeunes. Cette gaine est fendue si les deux bords ne se réunissent pas (Poaceae), soit même fermée si ses bords se soudent : la feuille forme alors un véritable cylindre. De plus, cette gaine est souvent surmontée d'une ligule.
Le faux limbe, généralement rectiligne, peut devenir galbé, ce qui lui donne l'aspect d'une feuille de Magnolopsides (Araceae,
Smilax...). Cette interprétation morphologique est confirmée par la physiologie, le limbe et le pétiole ont besoin pour croître de substances de croissance différentes (adénine pour le limbe, auxine pour le pétiole). Les feuilles de Liliopsides ne réagissent qu'à l'auxine.
Appareil reproducteur
Alors que par rapport aux Magnolopsides ancestrales, l'appareil végétatif des Liliopsides a subi une évolution considérable, les fleurs ont au contraire conservé un type relativement archaïque, le type 3. En particulier, évolution ne s'est pas traduite, comme chez les Magnolopsides, par la pentamérie. La plupart des fleurs de Liliopsides sont régies par une formule florale assez uniforme : 3S + 3P + (3+3) E + 3C, qui est celle d'une fleur pentacyclique trimère.
De façon générale, les deux verticilles du périanthe sont concolores. Soit les pétales deviennent sépaloïdes, soit, le plus souvent, les sépales deviennent pétaloïdes (Liliaceae). On donne à ces pièces le nom général de tépales, qui ne préjuge pas de leur aspect. On peut donc écrire (3+3) T + (3+3) E + 3C. Les pièces de ces deux verticilles peuvent également se souder par leurs bords, donnant un périanthe gamophylle, qui, chez les Liliopsides, n'est pas un caractère déterminant au niveau de la systématique.
Les carpelles sont soudés entre eux, de façon à former un ovaire composé, les ovules sont nombreux. Le fruit, multiseminé est une baie ou une capsule. La graine est albuminée.
Les fleurs ne sont accompagnées que d'une seule prefeuille qui se situe à l'opposé de la bractée mère. Les fleurs, parfois isolées, sont le plus souvent groupées en inflorescence, dont le type est très varié. l'inflorescence, contrairement aux rameaux feuillés, peut en effet se ramifier.