L'inflorescence est une ombelle, pouvant définir la famille. L'ombelle est constituée par des pédoncules floraux, ou rayons, divergeant sensiblement d'un même point, les fleurs s'épanouissent toutes à un même niveau. Chaque rayon est axilé, en principe, par une bractée, mais seules les plus externes persistent généralement et forment l'involucre de l'ombelle. Chez
Astrantia, ces bractées deviennent pétaloïdes, chez les
Eryngium, elles sont foliacées et épineuses. Chez certaines espèces d'
Hydrocotyle et d'
Azorella, l'ombelle est très modifiée, réduite à une fleur. Chez
Petagnia, l'ombelle est composée de petites cimes bipares.
Les fleurs les plus périphériques sont mûres les premières, ce qui s'explique en considérant que l'ombelle est une grappe dont l'axe est réduit à un réceptacle extrêmement court. Chez certaines espèces, la fleur centrale est morphologiquement différente : chez
Daucus carotta, elle est rouge alors que les autres sont blanches, ce qui a permis à certains auteurs de penser que l'ombelle dériverait d'une cyme plutôt que d'une grappe.
L'ombelle simple est rarement isolée. Elle est à son tour groupée en inflorescence (grappes d'ombelles, cymes d'ombelles, ombelles prolifère où des ombelles se succèdent le long de l'axe principal), chez la majorité des cas, les ombellules (ombelles primaires) sont disposées en ombelles. On dit alors que l'on a des ombelles composées formées d'ombelles d'ombellules avec involucres et involucelles. Les fleurs sont aussi disposées côte à côte, par dizaines, centaines ou même milliers, à la surface de toutes les ombellules juxtaposées, surface tapissée d'étamines et de pistils nectarifères, parfumée, et se prêtant admirablement au jeu des insectes pollinisateurs. Ces grands ensembles floraux tendent à s'organiser.
Les inflorescences ainsi constituées tendent à simuler une fleur. Les pétales les plus externes des fleurs périphériques deviennent plus grands et donnent l'aspect d'une corolle géante (
Daucus carotta,
Turgenia latifolia,
Artedia squamata, etc), jouant ainsi un rôle attractif pour les insectes pollinisateurs. L'impact visuel est encore accru par une augmentation du nombre et de la taille des ombellules, et un rapprochement des fleurs individuelles.
Chez les
Echinophora s'observe une remarquable réduction de l'inflorescence : une fleur centrale limitée à son gynécée est entourée par un cercle de fleurs à périanthe très zygomorphes et réduites à leur androcée. L'ensemble est comparable à une fleur, avec ses pétales, ses étamines périphériques et ses carpelles centraux.
 Fig. 1 : L'ombelle des Apiaceae. A - Ombelle et ombellules dépourvues d'involucre et d'involucelle chez Foeniculum vulgare; B - Ombelle et ombellules munies d'involucre et d'involucelle chez Daucus carotta; C - Ombelle réduite et ombellules munies d'involucelles chez Aethusia cynapium; D - Ombelle capituliforme aux rayons nuls chez Eryngium planum
Fig. 1 : L'ombelle des Apiaceae. A - Ombelle et ombellules dépourvues d'involucre et d'involucelle chez Foeniculum vulgare; B - Ombelle et ombellules munies d'involucre et d'involucelle chez Daucus carotta; C - Ombelle réduite et ombellules munies d'involucelles chez Aethusia cynapium; D - Ombelle capituliforme aux rayons nuls chez Eryngium planum
Les
Brassicaceae présentent parfois des phénomènes analogues, lorsque la grappe devient aplatie et très condensée, et il est intéressant de remarquer cette convergence morphologique entre deux familles éloignées l'une de l'autre. De telles inflorescences, facilement parcourues par les insectes, ont l'avantage de permettre une pollinisation en série, un seul animal fécondant un grand nombre de fleurs.
La plupart des Apiaceae sont pollinisées par les insectes, principalement des mouches, moustiques, ou par certaines abeilles et papillons non spécialisés. L'autofécondation est pourtant fréquente : les pistils sont souvent pollinisés par les anthères des fleurs adjacentes dans la même ombelle. L'absence presque totale d'hybridation est un caractère curieux de la famille.
Souvent, les ombelles sont protandres, même si certains genres comme
Hydrocotyle et
Sanicula sont protogynes, de sorte que l'autopollinisation est difficile. La différenciation sexuelle chez les ombelles est très marquée dans certains cas, et varie d'un genre à l'autre, selon le degrés de protandrie, allant de quelques fleurs mâles par ombelles à des ombelles exclusivement composées de fleurs mâles. Qui plus est, il existe chez quelques espèces des tendances à l'agencement des fleurs mâles autour des fleurs femelles. Morphologiquement et biologiquement, l'ombelle tend à devenir un pseudanthe et à s'organiser comme une fleur : ce degrés d'organisation est très comparable à celui des capitules des
Asteraceae.
 Fig. 2 : La fleur des Apiaceae : A, B et D - Détail d'une fleur chez Foeniculum vulgare,
Fig. 2 : La fleur des Apiaceae : A, B et D - Détail d'une fleur chez Foeniculum vulgare,
ainsi que sa coupe longitudinale et son diagramme;
C - Détail d'une fleur chez Scandix pecten-veneris
La fleur est le principal facteur d'unité. Petites, généralement hermaphrodites et actinomorphes, elles sont épigynes. Le périanthe est constitué d'un calice réduit ou courtement tubulaire et adné au gynécée, et de 5 pétales libres.
L'androcée consiste en 5 étamines libres. L'ovaire est infère et biloculaire, composé de 2 carpelles antéro-postérieurs soudés suivant un plan appelé commissural. Chaque loge renferme un ovule unique, anatrope et pendant. A la base des deux styles se trouvent deux disques nectarifères, appelés stylopodes, dont la position très superficielle, soutenant les styles, permet la pollinisation par les Diptères, insectes dont la trompe buccale est courte. Les variations de ce schéma floral sont très limitées : des corolles plus ou moins zygomorphes avec des pétales externes plus grands et radiés, ou des fleurs unisexuées. Le stylopode est un organe caractéristique de la famille qui varie beaucoup en forme, taille, couleur et sécrétion nectarifère.
 Fig. 3 : Le fruit des Apiaceae. A et B - Détail d'un fruit chez Foeniculum vulgare,et
Fig. 3 : Le fruit des Apiaceae. A et B - Détail d'un fruit chez Foeniculum vulgare,et
sa coupe longitudinale; C et D - Détail d'un fruit
chez Aethusia cynapium,et sa coupe longitudinale;
E - Détail du fruit chez Scandix pecten-venris
Le fruit est facteur à la fois d'unité et de diversité dans la famille.
Facteur d'unité, il est toujours un diakène : sec et indéhiscent, il se sépare, à maturité, en deux méricarpes représentant chacune un akène. Les méricarpes séparés restent, jusqu'à leur dispersion, suspendus, par leur face commissurale, aux deux branches d'un système ligneux en Y, le carpophore, axe du fruit détaché des tissus environnants. Dans les parois de chaque méricarpe existent des faisceaux libéro-ligneux et des canaux sécréteurs méridiens. des cristaux d'oxalate de calcium peuvent être présents dans le péricarpe.
Facteur de diversité, le fruit est modulé suivant les formes les plus variées. Il est globuleux, ovoïde ou lenticulaire, aplati, parallèlement ou perpendiculairement à la commissure ; il est glabre ou poilu, lisse, verruqueux, hérissé de pointes ; ou bien il porte des crêtes ou ailes méridiennes avec les faisceaux conducteurs et les canaux sécréteurs méridiens réalisent les combinaisons les plus différentes. Tous ces caractères sont utilisés pour la distinction des genres, et sont rattachés au mode de dispersion. Certains fruits ont des constructions remarquables qui ressemblent peu à ceux des Apiaceae typiques, comme ceux des
Petagnia,
Scandix,
Thecocarpus.
La graine possède un albumen gras et plat ou concave, dit commisural, et un petit embryon.
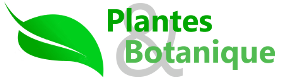

 La famille est présente dans la majeure partie du globe, mais elle est plus commune dans les régions montagneuses tempérées et relativement rare dans les régions tropicales. Ses trois sous-familles ont une distribution caractéristique. La plus grande, les Apioideae est bipolaire, mais surtout développée en Eurasie, les Saniculoideae sont aussi bipolaires, mais surtout distribuées dans l'hémisphère sud, et les Hydrocotyloideae sont surtout présentes dans l'hémisphère sud.
La famille est présente dans la majeure partie du globe, mais elle est plus commune dans les régions montagneuses tempérées et relativement rare dans les régions tropicales. Ses trois sous-familles ont une distribution caractéristique. La plus grande, les Apioideae est bipolaire, mais surtout développée en Eurasie, les Saniculoideae sont aussi bipolaires, mais surtout distribuées dans l'hémisphère sud, et les Hydrocotyloideae sont surtout présentes dans l'hémisphère sud.


