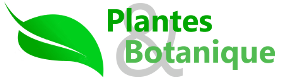Les fleurs sont solitaires ou rassemblées en panicules, en fascicules, en racèmes, en épis ou en têtes axillaires et terminales ou opposées aux feuilles comme chez certains membres des Bossiaeeae. Elles sont bisexuées, et la pollinisation est entomophile, ornithophile, en particulier chez de nombreuses espèces du sud de l'Australie, ou encore, plus rarement, cheiropterophie (chez
Mucunna holtonii par exemple, un des pétale est concave et sert à refléchir les ultrasons). Enfin, chez certaines espèces de
Medicago, elle est explosive et se fait de proche en proche.
Elles sont plus ou moins zygomorphes, rarement actinomorphes (certaines Sophoreae et Swartzieae), parfois resupinées ou calyptrées. Le caractère zygomorphe de la fleur des Fabaceae est dû au périanthe ainsi qu'à l'androcée. Elles sont tetracycliques, plus rarement tricycliques. Le receptacle floral développe parfois un gynophore, souvent plus ou moins cupuliforme. Un hypanthium libre est aussi quelquefois présent, comme par exemple chez les Dalbergieae.
Le calice est composé de 5 sépales généralement soudés, imbriqués ascendants, le median étant antérieur, fréquemment inégaux, et est parfois bilabié (
Spartium), persistant ou caduc (
Lamprolobium), généralement non accrescent. Il est dans certains cas entouré d'un épicalice, qui peut résulté de la soudure des bractéoles, comme chez
Pullenaeae. La corolle est caractéristique. Generalement constituée par 5 pétales, parfois moins (Amorphieae, Swartzieae), libres ou plus ou moins connés, elle est zygomorphe. Le pétale postérieur, dressé (étendard) recouvre les pétales latéraux (ailes), qui recouvrent eux-mêmes les deux pétales antérieurs, plus ou moins soudés en une pièce en forme de carène. La préfloraison est ainsi caractérisée par une imbrication descendante. Chez les
Trifolium, où les fleurs sont très serrées dans l'inflorescence, l'ensemble des pétales peut se souder ; la corolle devient gamopétale, elle est de plus persistante. Ce schéma est constant, et ne varie qu'un peu dans quelques tribus, comme les Sophoreae, les Swartzieae et les Amorphieae. Les pétales sont parfois auriculés ou appendiculés. Chez quelques genres, comme
Lens,
Pisum,
Vicia par exemple, les ailes sont connées à la carène.
 Fig. 2 : La fleur des Fabaceae. A - Diagramme floral chez Phaseolus vulgare; B - La corolle chez Erythrina crista-galii : 1 et 2 vues des fleurs, 3 étandart, 4 ailes et 5 carène; C - Androcée diadelphe (6) et monadelphe (7)
Fig. 2 : La fleur des Fabaceae. A - Diagramme floral chez Phaseolus vulgare; B - La corolle chez Erythrina crista-galii : 1 et 2 vues des fleurs, 3 étandart, 4 ailes et 5 carène; C - Androcée diadelphe (6) et monadelphe (7)
L'androcée comporte 9-10 étamines, parfois moins ou plus, comme chez quelques représentants des Swartzieae et des Sophoreae, et il est essentiellement diplostémone, plus rarement tri- ou multistémone. Elles sont quelquefois adnées au périanthe (Dalbergieae, Mirbelieae,
Trifolium,
Genista>, ...). Parfois libres et égales, elles sont souvent diversement soudées entre elles et parfois inégales : dans ce cas, on distingue deux configurations principales : l'androcée est monadelphe quand toutes les étamines sont soudées (
Genista, Spartium), et, plus frequemment, il est diadelphe quand 9 des étamines sont soudées, l'étamine postérieure restant libre. Toutes sont fertiles, exceptés dans quelques genres ou l'on trouve des staminodes (
Robynsiophyton). Les anthères sont libres ou conniventes, dorsifixes ou basifixes, versatiles ou non, à dehiscence introrse ou latrorse, par des fentes longitudinales. Elles sont généralement biloculaires, parfois uniloculaires par confluence partielle des loges. Elles sont parfois pourvues d'appendages, de nature glanguleux chez
Indigofera par exemple.
L'ovaire est supère, unicarpellé et uniloculaire, tres exceptionellement biloculaire par apparition d'une fausse cloison (
Mirbelia). Il est sessile ou stipité. Le carpelle, ventral det généralement allongé, renferme entre 2 et de très nombreux ovules, pendants à ascendants et biseriés, et la placentation est marginale. Parfois arillés, ils sont anbatropes, campylotropes ou amphitropes, bitegumentés et crasinucellés. Le style est apical.
Le fruit est un légume charnu ou non, dehiscent ou plus rarement indehiscent, parfois lomentacées. La dehiscence est double : ventrale, le long de la ligne de suture du carpelle, et dorsale, au niveau de la nervure principale de la feuille carpellaire. La gousse peut, chez certaines espèces, se transformer secondairement. Ces variation sont identiques à celles décrites pour les siliques des
Brassicaceae. Ainsi :
- la gousse peut devenir pauciséminée, et alors indéhiscente : akène des Onobrychis,
- la gousse, bien que multiséminée, peut perdre ses déhiscences dorsales et ventrales. Elle devient lomentacée. Dans les cas les plus primitifs, les graines sont libérées par pourriture du fruit (Sophora), mais également la gousse acquiert une désarticulation secondaire en segments akènoïdes : Coronilla,
- la gousse peut prendre également une fausse cloison longitudinale par introflexion : Astralagus,
- la gousse peut devenir spiralée ou arquée (Medicago), vésiculeuse (Colutea), ailée et charnue...
- dans quelques cas, la gousse peut acquerir une morphologie samaroide ou drupacée.
 Fig. 3 : Le fruit des Fabaceae. A - La gousse typique des Fabaceae chez Phaseolus ; B - Gousse spiralée chez Medicago sativa ; C - Gousse à intraflexion chez Astragalus ; D - Gousse bisperme chez Lens culinaris ; E - Gousse pauciséminée devenue indehiscente chez Arachis hypogea ; F - Gousse uniséminée et indehiscente de type akenoide chez Lathyrus ; G - Gousse monosperme, indehiscente et ailée de type samaroide chez Toluifera ; H - Gousse lomentacée chez Sophora japonica ; I - Gousse articulée chez Coronilla ; J - Gousse articulée chez Hippocrepis
Fig. 3 : Le fruit des Fabaceae. A - La gousse typique des Fabaceae chez Phaseolus ; B - Gousse spiralée chez Medicago sativa ; C - Gousse à intraflexion chez Astragalus ; D - Gousse bisperme chez Lens culinaris ; E - Gousse pauciséminée devenue indehiscente chez Arachis hypogea ; F - Gousse uniséminée et indehiscente de type akenoide chez Lathyrus ; G - Gousse monosperme, indehiscente et ailée de type samaroide chez Toluifera ; H - Gousse lomentacée chez Sophora japonica ; I - Gousse articulée chez Coronilla ; J - Gousse articulée chez Hippocrepis
Les graines, résultant d'un ovule courbe, sont elles mêmes arquées. Elles possèdent un endosperme mince, plus frequemment absent, et sont presque toujours non ailées. Elles sont riches en amidon, aleurone et huile, la richesse aleuroniques en protéines résulte de la symbiose avec les
Rhizobium. Selon les genres, c'est l'une ou l'autre de ces substances de réserve qui prédomine : amidon du pois, du haricot, des fèves, huile de l'arachide, protéines du soja... Les cotylédons sont généralement plats, et l'embryon est chlorophyllien et frequemment courdé. La germination est phanérocotylée ou cryptocotylée.