Les Ranunculaceae représentent le type même de la famille par enchaînement : les espèces à structure primitive diffèrent fortement des espèces plus évoluées, mais sont reliées entre elles par de nombreux intermédiaires. Aussi, les Ranunculaceae forment un groupe bien enchaîné assez facile à délimiter, mais qui, inversement, ne présente que peu de caractères communs à tous les genres. Le seul véritablement commun est l'embryon qui est de petite taille et qui est entouré d?un albumen charnu.
Les Ranunculaceae sont maintenant généralement considérées comme une famille primitive, un point de vue avancé par Antoine Laurent de Jussieu en 1773. Elle est considérée par beaucoup comme ayant probablement peu évolué à partir d'un stock ancestral équivalent à celui des
Magnoliales.
La famille est rattachée aux
Menispermaceae, aux
Lardizabalaceae et aux petites familles monogénétiques des
Hydrastidaceae et des
Circaesteraceae. Les Ranunculaceae et les
Berberidaceae sont également proches d'un point de vue chimique par la possession d'un alcaloïde, la berberine.
Les Ranunculaceae sont divisées en 2 sous familles et 5 tribus.
La première sous famille, les
Helleboroideae ont un gynécée cyclique, et les méricarpes verticillés, contenant plusieurs graines, s'ouvrent par une fente correspondant à la suture de la feuille carpellaire. Chez quelques genres exceptionnels, les méricarpes, plus ou moins concrescents, forment un fruit capsulaire (
Nigella) ; ou bien le pistil unicarpellé devient une baie (
Actaea). On distingue deux tribus :
- les
Helleboreae à fleurs régulières :
Caltha, Calathodes, Trollius, Helleborus, Eranthis, Coptis, Isopyrum, Nigella, Actaea, Aquilegia, Xanthorrhiza ;
La fleur des
Helleborus n'est pas sans rappeler, du moins dans tous les éléments extérieurs au gynécée, celle des nénuphars : un calice, constitué de cinq grands sépales, entoure une corolle, formée d'un cercle de petits cornets staminodiaux, dont chacun est continué, sur une hélice très serrée, par une file d'étamines. Le gynécée, verticillé, ne comporte que trois carpelles libres.
Les
Caltha, plantes des marais, aux 5 sépales jaunes, sont dépourvus de corolle.
Chez les
Aquilegia, genre de l'hémisphère nord, le périanthe est formé de deux verticilles pentamères, l'un et l'autre également développés, mais dissemblables : le verticille externe est constitué par cinq lames pétaloïdes bleues ou roses, le verticille interne par de longs cornets nectarifères, à pointe droite ou courbe, bleus ou jaunes. l'androcée, multistaminé, est cyclique, de même que le gynécée, qui comprend cinq carpelles libres.
Les
Nigella ont des carpelles peu nombreux qui sont plus ou moins soudés par leurs parois latérales, caractère exceptionnel chez l'ordre et même chez la sous-classe. Leurs feuilles sont très découpées, ainsi que les pièces de leur involucre floral.
Les
Eranthis épanouissent au premier printemps leur calice de 6 sépales jaunes ; ils montrent une involucre comme chez les
Anemone.
- les
Delphinieae à fleurs irrégulières :
Aconitum, Delphinium et
Consolida.
Dans les deux grands genres
Delphinium et
Aconitum, le périanthe est zygomorphe ; les sépales, bleus, jaunes, blancs, suivant les espèces, sont très développés et le postérieur offre la forme d'un casque (
Aconitum) ou d'un éperon (
Delphinium). La corolle nectarifère, beaucoup plus discrète, comprend, chez les aconits, 2 grands nectaires (cornets stipités) situés sous le casque et 2-6 petits nectaires sous les autres sépales, et chez les
Delphinium, deux grands nectaires en cornet engagés dans l'étui qu'est le sépale de même forme et, généralement, deux autres petits nectaires situés sous l'entrée de l'éperon.
Chez les
Consolida ces trois nectaires sont soudés en une seule pièce en cornet. l'androcée, dans lequel les étamines sont moins nombreuses que chez les ancolies, est cependant encore acyclique. Le gynécée comprend, chez les aconits, 3-5 carpelles et, chez les
Delphinium, 1-5 carpelles libres.
Les
Delphinium et les
Consolida sont deux genres très apparentés, différant aussi par le fait que le premier groupe des herbes vivaces, et que le secong englobe des herbes annuelles.
La seconde sous famille est celle des
Ranunculoideae, aux carpelles uniovulés et formant le plus souvent des akènes secs. Le gynécée est acyclique et les méricarpes, contenant une seule graine, sont indéhiscents. On y distingue :
- les
Ranunculeae aux feuilles radicales ou alternes, aux fleurs sans involucre, au calice imbriqué souvent caduc, aux pétales à glandes nectarifères rarement absents, aux akènes secs rarement charnus :
Ranunculus, Trautvetteria, Hamadryas, Myosorus, Callianthenum, Adonis, Knowltonia et
Thalictrum.
Les
Ranunculus sont des plantes herbacées, communes, vivaces par un court rhizome enveloppé par les gaines foliaires. Celles-ci sont alternes et pour la plupart palmatipartites, et dépourvues de stipules. Les fleurs sont régulières (5S + 5P + nE + nC). Sépales et pétales, souvent jaunes ou blancs, sont disposés en verticilles alternes ; les étamines et les carpelles en spirales autour d'un thalamus. Les pétales portent à leur base un petit onglet nectarifère. Les étamines ont une déhiscence extrorse. Chaque carpelle est indépendant et renferme un ovule anatrope. Celui-ci devient un akène. Les fleurs jaunes du
R. ficaria (
Ficaria ranunculoides) montrent trois sépales seulement et de 6 à 12 pétales, et ses racines sont tubérisées.
Les
Myosorus sont des Renonculées à 5 sépales, pourvus chacun d?un éperon nectarifère, et à 5 pétales courts. Le thalamus est long de plusieurs centimètres et délié. Il stimule une queue de rat, d'où son nom.
- les
Anemoneae aux feuilles radicales ou caulinaires alternes, aux fleurs fréquemment pourvues d?une involucre, aux sépales se chevauchant, généralement pétaloïdes et persistants pendant la floraison et aux akènes secs :
Anemone, Pulsatilla, Hepatica, Barneoudia.
Dans les fleurs des
Anemone le périanthe, composé d?un ensemble variable (4, 7, 8, ou plus chez les anémones) de pièces pétaloïdes blanches, rouges, bleues, violettes, n'est pas différencié en calice et corolle ; les étamines, très nombreuses, sont insérées sur des spires à tours très serrés ; leurs anthères s'ouvrent par des fentes, caractère important en raison de sa constance dans l'ensemble de la famille. La tige florifère porte, très au-dessous de la fleur, un involucre, verticille de trois feuilles plus ou moins découpées. l'hépatique (
Hepatica triloba, ou
Anemone hepatica) ne diffère des vraies anémones que par la simplification de ces trois pièces involucrales, devenues trois lobes verts, petits et non découpés, et par l'extrême raccourcissement de l'entre-noeud intercalé entre le verticille involucral et la fleur. Les trois petits lobes en question, situés immédiatement sous le périanthe, constituent, en fait, un calice trimère, tandis que les pièces pétaloïdes qui le surmontent représentent une corolle. Le fruit est un akène surmonté d'un style concrescent devenant plumeux.
- les
Clematideae aux tiges herbacées ou ligneuses et grimpantes, aux feuilles opposées, aux sépales valvaires, pétaloïdes, aux pétales absents ou représentés par les étamines externes et pétaloïdes ; aux akènes nombreux, souvent plumeux :
Clematis, Clematopsis, Knoltonia.
Les
Clematis sont des arbrisseaux sarmenteux aux feuilles opposées, ce qui constitue une exception dans la famille. Leurs pétioles sont volubiles et accrochent la plante aux supports. Leurs fleurs, aux 4 sépales blancs ou bleus sont sans corolles, comme chez les
Anemone. Le style s'allonge aussi après la fécondation en un long organe plumeux.
Le genre
Paeonia, les pivoines, a depuis quelques temps été individualisé en tant que famille des
Paeoniaceae.
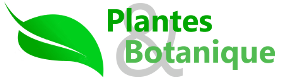

 La famille est répartie à travers le monde entier, mais est concentrée dans les régions tempérées et froides des deux hémisphères, et en particulier de l'hemisphère nord. Seul, le genre Clematis est mieux représenté dans les régions tropicales que dans les régions tempérées.
La famille est répartie à travers le monde entier, mais est concentrée dans les régions tempérées et froides des deux hémisphères, et en particulier de l'hemisphère nord. Seul, le genre Clematis est mieux représenté dans les régions tropicales que dans les régions tempérées.












































